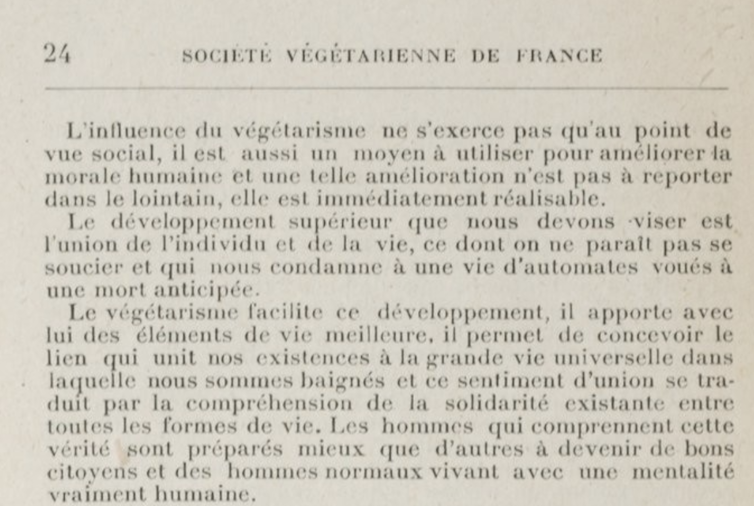Modifier notre régime alimentaire peut-il aider à résoudre les grands défis de l’humanité ? C’est ce qu’affirment divers acteurs – essayistes médiatiques, militants de la protection animale et de l’écologie ou experts –, qui défendent la nécessité de limiter notre consommation de viande et de produits d’origine animale. Les principales raisons avancées pour promouvoir le végétarisme sont généralement l’écologie, la santé et la cause animale, voire plus largement la justice sociale.
À la fin du XIXe siècle, dans un autre contexte, le végétarisme apparaît déjà comme un moyen de résoudre les grands problèmes sociaux liés à l’urbanisation et à l’industrialisation. Que nous apprend la promotion de ce régime alimentaire sur les manières d’envisager les problèmes sociaux et, plus largement, de faire société ?
Les multiples promesses du végétarisme
Selon les sensibilités idéologiques, les grandes causes auxquelles le végétarisme est censé apporter une solution sont hiérarchisées de différentes manières dans les argumentaires. Par exemple, tandis que Greenpeace dénonce surtout l’impact écologique de l’élevage, l’association L214 voit d’abord le végétarisme comme un moyen indispensable pour mettre fin aux maltraitances animales.
Bien entendu, de nombreux militants dépassent fréquemment la segmentation des objectifs et lient ces différentes causes entre elles. Ainsi, pour certains essayistes médiatiques, comme Hugo Clément ou Aymeric Caron, tous deux végétariens, la défense de la cause animale est une étape indispensable pour servir la cause écologique. Ce dernier, tout comme Thomas Lepeltier, considère que le végétarisme est appelé à se généraliser pour devenir la norme, impliquant ainsi un changement de société dans laquelle les animaux ne sont plus réduits à être exploités par les hommes. De même, pour les théoriciens de l’altruisme efficace, comme Peter Singer, il est nécessaire de décloisonner ces causes humanitaires afin de provoquer de réels changements sociaux.
Aymeric Caron parle de son livre « Vivant » dans l’émission C l’hebdo, le 17 octobre 2018.
Les défenseurs du végétarisme proposent des modes d’action variés. Si certains prônent des actions collectives visant à faire évoluer la réglementation de la protection animale, comme c’est le cas de L214, d’autres considèrent que le changement social passe, au moins dans un premier temps, par une démarche individuelle. Par exemple, le mouvement Colibris, fondé en 2007 par Pierre Rabhi et Cyril Dion, prend pour principe la métaphore du colibri qui tente d’éteindre un incendie en prenant quelques gouttes d’eau dans son bec, devant l’incrédulité des autres habitants de la forêt : si chacun fait sa part, aussi infime soit-elle, il devient alors possible de changer les choses.
De l’action individuelle et locale à la réforme de la société
L’idée que l’individu possède une responsabilité dans les grands problèmes sociaux de son temps et qu’il est, du même coup, capable de participer à leur résolution en réformant son propre mode de vie a pu exister dans d’autres contextes. Au XIXe siècle, des réformateurs sociaux considèrent que les problèmes des classes populaires industrieuses sont liés à leur comportement et leurs mauvaises mœurs.
Parmi eux, comme l’a montré le sociologue Arouna Ouédraogo, des réformateurs sociaux perçoivent le végétarisme comme une solution à ces problèmes dès la première moitié du XIXe siècle en Angleterre, où l’abstinence de viande est préconisée par des pasteurs et des sectes protestantes. Elle est alors censée favoriser le relèvement moral des populations. Ces idées essaiment aux États-Unis, où elles séduisent également des médecins et scientifiques comme le célèbre Dr John Harvey Kellogg. Elles prennent alors une dimension hygiéniste : en plus de contribuer à l’élévation morale des individus, le végétarisme est censé résoudre les problèmes de santé et fortifier les corps.
Plus largement, dans les pays occidentaux, les végétariens de la fin du XIXe siècle, sont inspirés par Léon Tolstoï et son texte La première étape (1883), dans lequel il affirme que l’abstinence de viande et le refus du meurtre des animaux constituent la première étape d’un parcours spirituel et moral vers la perfection de l’homme. Ainsi, de proche en proche, l’adoption du végétarisme par les individus est supposée améliorer la société dans son ensemble.
Autour de 1900 : diffuser le végétarisme pour moraliser
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, des sociétés végétariennes sont fondées en Europe continentale, comme en Allemagne, en Suisse, mais aussi – de manière moins connue – en France, où est créée la Société végétarienne de France (S.V.F.) en 1881. Selon les membres de cette dernière, le végétarisme est un régime alimentaire doté de nombreuses vertus. D’une part, il proscrit toutes formes d’« excitants », au premier rang desquels la viande, mais aussi l’alcool, le tabac, le café et le thé. De ce fait, il possède des synergies avec les mouvements de lutte contre l’alcoolisme. D’autre part, puisqu’il fortifie les corps, il permet de lutter contre la dépopulation et les maladies comme la tuberculose et la goutte.
 Un extrait du Bulletin de la Société végétarienne de France, janvier 1920. Gallica
Un extrait du Bulletin de la Société végétarienne de France, janvier 1920. Gallica
Plus encore, si l’on en croit le Dr Goyard, président de la S.V.F au début des années 1880, il est même capable d’éradiquer non seulement les guerres, mais aussi les divorces, puisqu’il « apaise l’irritabilité, égaye l’humeur sombre, glisse un rayon de lumière et de chaleur dans le cœur glacé ». Pour ces promoteurs du végétarisme, ce régime alimentaire est le régime « naturel » de l’homme, dont l’instinct a été corrompu par le mode de vie urbain et ses mauvaises habitudes alimentaires. Dès lors, la seule solution à leurs yeux est de guider les populations par la raison pour les conduire à adopter le végétarisme.
Comment ces mouvements végétariens d’Europe occidentale procèdent-ils, au tournant des XIXe et XXe siècles, pour propager leurs idées ? En premier lieu, ils assurent la publication d’un ensemble d’écrits, entre science, vulgarisation et militantisme, pour tenter de toucher le grand public. En second lieu, ils s’appuient sur des relais d’opinion – membres du clergé, instituteurs et médecins – qui participent à des congrès internationaux, donnent des conférences, prêtent des ouvrages ou assurent des campagnes d’affichage. Enfin, afin de faciliter la pratique du régime, ils mettent à la disposition du plus grand nombre, à des prix accessibles, les denrées alimentaires et les équipements nécessaires : pain de Graham (pain à base de farine complète, sans levain ni sel), café de santé, bouillies protéinées, mais aussi ustensiles de cuisine et livres de recettes. À partir de la Belle époque s’ouvrent des épiceries, des restaurants, des pensions mais également des colonies de vacances et des cures thermales, dédiés au végétarisme.
 Un restaurant végétarien en 1900. Archives des Hauts de Seine
Un restaurant végétarien en 1900. Archives des Hauts de Seine
Changer de régime alimentaire : une question de « bonne volonté » ?
Ainsi, au tournant des XIXe et XXe siècles, le végétarisme est surtout préconisé et pratiqué par des élites sociales. Il repose sur l’idée que la réforme des comportements individuels est possible grâce à l’éducation des masses. L’alimentation est donc considérée comme une affaire de rationalité et de philosophie morale : les individus les plus vertueux sont ceux qui sont capables, par leur volonté, de mettre en cohérence leurs pratiques alimentaires avec leurs convictions éthiques. Cette conception se retrouve, de nos jours, chez certains militants écologistes, comme le montrent les recherches de Florence Faucher, chez des militants de la cause animale, ou encore chez des promoteurs du végétarisme pour raisons de santé.
Toutefois, les travaux actuels en sociologie de l’alimentation s’attachent à souligner qu’en matière de régime alimentaire, tout n’est pas qu’affaire de volonté ni d’éducation. La théorie des pratiques, portée par des sociologues nord-européens comme Alan Warde, Elizabeth Shove, David Evans et Bente Halkier, montre que l’alimentation implique un ensemble de pratiques imbriquées et coordonnées : aller faire ses courses, composer son menu, gérer ses réserves, faire la cuisine, manger, jusqu’à la gestion des restes alimentaire. De plus, ces pratiques prennent place au sein de foyers diversement composés ou de modes de restauration collective en prise avec de nombreuses normes sociales et symboliques qui entourent le repas – les réactions virulentes à la proposition de la mairie de Lyon d’instaurer des menus sans viande pour tous en sont un exemple. Les pratiques alimentaires sont aussi prises dans des rythmes quotidiens et des routines, des goûts (et dégoûts) particuliers. On comprend alors qu’un changement de régime alimentaire est plus complexe qu’il n’y parait, parce qu’il implique des changements systémiques.
Le détour par l’histoire de la promotion du végétarisme au XIXe siècle permet de constater la tension entre l’universalité des résultats attendus et le caractère individuel des actions censées produire ces résultats. Le végétarisme permet ainsi de repenser la question des liens sociaux et de la solidarité, dans un cadre où le changement social espéré est pensé comme le résultat de la somme des comportements individuels.
Alexandra Hondermarck, Doctorante en sociologie, Sciences Po
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original. crédit photo: pixabay